REVUE DE PRESSE !
Disparition des petites fermes : la France rurale s’effrite dans un silence assourdissant
Quarante mille petites fermes rayées de la carte en trois ans.
Le chiffre, révélé par le mouvement citoyen Terre de Liens, n’a rien d’une statistique de plus : c’est un séisme rural.
Une disparition massive, continue, presque silencieuse, qui bouleverse l’architecture même de nos campagnes.
Depuis 1988, neuf départements sur dix ont perdu plus de la moitié de leurs exploitations.
En Bretagne comme dans le Nord, les zones les plus productives, près des trois quarts des fermes ont déjà disparu.
Les chiffres ne racontent pas seulement une crise : ils dessinent un basculement historique.
Une France rurale absorbée par le productivisme
La tendance est connue, mais elle accélère : les petites fermes ferment, absorbées par de grandes exploitations toujours plus capitalisées, toujours plus spécialisées. Les terres se concentrent, les outils se modernisent, mais l’emploi disparaît.
Dans de nombreux villages, les derniers éleveurs quittent la scène comme on éteint les lumières après la fête.
Les terres changent de mains : souvent, un seul exploitant récupère ce que plusieurs familles cultivaient encore il y a trente ans.
Pour Terre de Liens, c’est un « plan social à bas bruit » qui se déroule sous nos yeux, sans le bruit des usines qui ferment, sans les caméras.
Mais avec les mêmes dégâts : chômage, perte d’activité, effondrement du tissu rural.
Les petites exploitations ne sont pas une nostalgie folklorique.
Elles structurent la vie des villages, la diversité des paysages, l’alimentation locale, et l’équilibre économique d’une région.
Dans de nombreux territoires, l’intensification pousse à une monoculture ou à des élevages géants, coupant le lien entre la terre et les habitants.
Le visage de la campagne se standardise, s’uniformise, s’appauvrit.
Un quart des agriculteurs partiront à la retraite d’ici 2030.
Et les remplaçants manquent cruellement.
Entre 2010 et 2020, la France a déjà perdu près de 100 000 agriculteurs.
Aujourd’hui, ils représentent à peine 1,5 % de la population active.
La France, pays agricole par excellence, se retrouve avec un secteur vieillissant, fragilisé, et de plus en plus dépendant des logiques industrielles et financières.
Si rien n’est fait, les prochaines années pourraient achever ce qu’il reste de la petite paysannerie française.
Bretagne : un cas emblématique
Terre de Liens l’illustre à travers une cartographie inédite.
En Bretagne, plus encore qu’ailleurs, la concentration est devenue la règle. L’élevage intensif a remodelé le territoire, au prix d’une disparition quasi totale des structures familiales de taille modeste.
Cette réalité bretonne pose une question cruciale : que devient une région quand son modèle agricole s’uniformise au point d’effacer tout le reste ?
Certaines collectivités refusent de baisser les bras. Aux Loges-en-Josas, dans les Yvelines, la municipalité a tout simplement racheté un terrain pour aider un habitant à devenir maraîcher.
Le bâtiment agricole a été financé par la commune.
Résultat : la réouverture d’une ferme après quinze ans de désert agricole, et des légumes qui reviennent dans les assiettes locales.
Ailleurs, des communes mettent en place des « zones agricoles protégées », achètent des terres pour les louer à des producteurs bio, ou créent des épiceries municipales pour soutenir les circuits courts.
Ces initiatives existent, fonctionnent, mais restent isolées.
Cinq leviers pour éviter un effondrement définitif
Pour Terre de Liens, l’enjeu est désormais politique et territorial.
Le mouvement appelle les maires à reprendre la main sur leurs terres et propose cinq axes majeurs :
– rendre accessibles les terrains agricoles pour les jeunes paysans ;
– recenser et protéger les terres restantes ;
– favoriser les pratiques respectueuses de l’eau et des sols ;
– soutenir les filières locales, notamment pour les cantines ;
– garantir un accès à une alimentation locale et de qualité pour tous.
Des mesures pragmatiques, mais qui supposent un engagement des élus… et un changement de paradigme national.
Derrière les chiffres, il y a une réalité que les grandes métropoles ne voient plus : la disparition d’un mode de vie, d’un savoir-faire, d’une manière d’habiter la terre.
La petite ferme n’est pas un vestige du passé.
C’est un équilibre, une culture, une organisation sociale.
C’est la base de notre souveraineté alimentaire.
Laisser mourir cette agriculture-là, c’est accepter que le pays ne maîtrise plus sa nourriture, son territoire, ni son avenir.
Et ce qui est en train de se jouer dans les campagnes françaises n’est rien d’autre qu’un choix de civilisation.
[cc] Article relu et corrigé (orthographe, syntaxe) par ChatGPT.
« Fils de paysan » : quand Philippe Royer appelle la France à sortir du virtuel et à retrouver le réel
Avec Fils de paysan, notre bon sens commun (Fayard), Philippe Royer publie un ouvrage qui ressemble moins à un essai qu’à un rappel collectif : celui d’un pays qui s’est éloigné de ses fondations et qui aurait, peut-être, intérêt à retrouver la simplicité, la cohérence et la stabilité d’un monde qu’il croyait dépassé.
Né dans une petite exploitation agricole de l’Orne, l’auteur raconte une enfance façonnée par le travail, la sobriété et une forme de joie tranquille que la modernité n’a pas su remplacer.
Mais il ne se contente pas de regarder en arrière : son livre interroge la France d’aujourd’hui, ses fractures, ses renoncements et les chemins possibles d’un redressement.
Royer n’idéalise pas le passé.
Il le regarde comme une source.
Ce qu’il appelle le « bon sens paysan » — ce rapport au temps long, cette connaissance de la nature, cette responsabilité quotidienne, cette modestie sans misère — structure l’ensemble de sa pensée.
Lorsqu’il retrace son parcours, de l’exploitation familiale à la direction d’une entreprise devenue vingt fois plus importante en vingt-cinq ans, il affirme y voir un fil rouge : ce qu’il a reçu jeune l’a protégé de la tentation du virtuel, du bavardage ou du renoncement.
Il décrit une France qui s’est peu à peu déconnectée du réel, au point de perdre la capacité d’assumer ce qui relève du concret : la transmission, l’effort, la continuité des liens, la protection des plus fragiles et l’autorité nécessaire pour faire tenir un pays.
Il ne cherche pas l’outrance.
Il constate, avec calme, que la société s’est habituée à croire qu’elle pouvait vivre sans ancrage, sans règles, et parfois même sans travail.
Ce décalage entre la culture rurale d’hier et la sociologie de demain est au cœur de sa réflexion : « on a coupé les racines en espérant que quelque chose de neuf pousserait », dit-il.
Il estime que c’est ce pari-là qui a échoué.
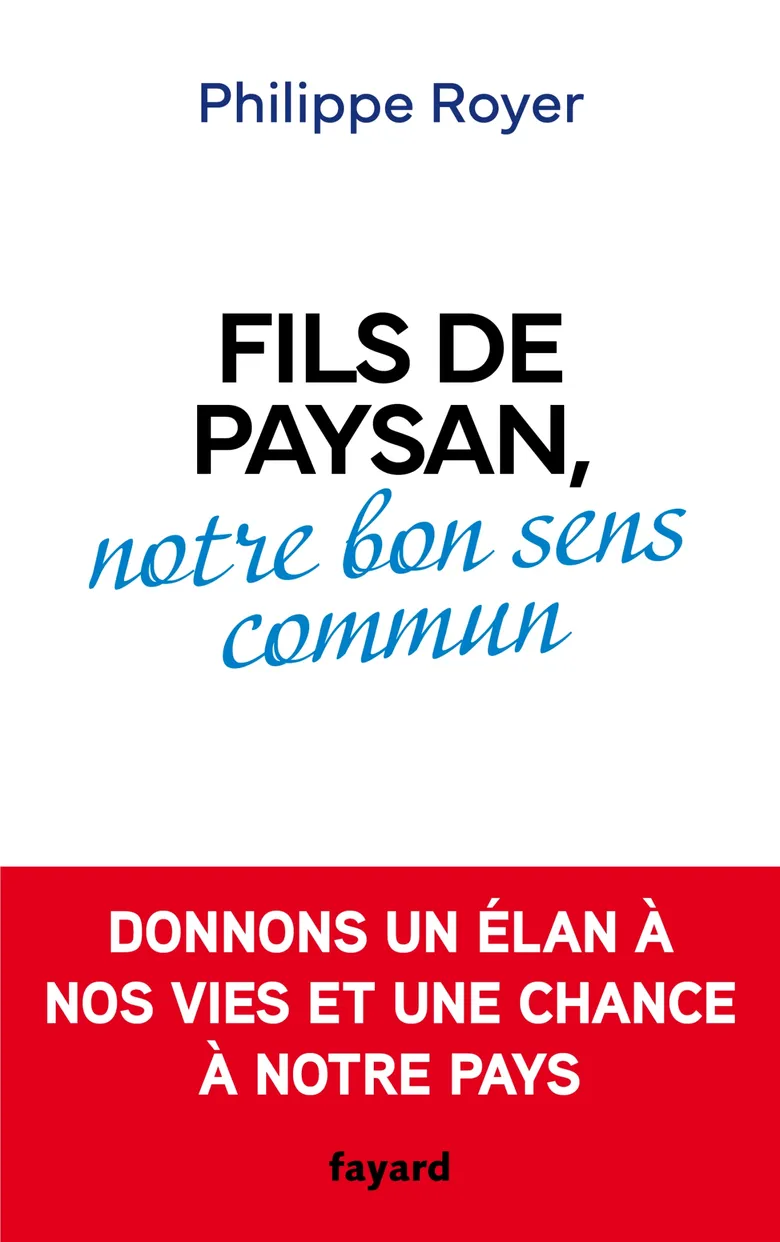
Sa vision n’est pas que sociologique : elle est aussi spirituelle.
L’ancien président des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens revendique une foi catholique redevenue centrale dans sa vie, non pour moraliser le politique, mais pour unifier l’homme.
À rebours de la fragmentation actuelle, il défend l’idée qu’on ne devrait pas être un individu au travail, un autre en famille, un troisième dans la vie intérieure.
Pour lui, cette cohérence personnelle est une condition pour agir avec justesse dans le débat public.
Il aborde également sans détour les questions liées à l’intégration, à la sécurité ou à l’autorité, refusant à la fois le déni et l’hystérie.
Royer ne nie pas que la société française soit devenue plus fragile, plus violente, plus incertaine.
Il dit simplement que l’État doit redevenir un garant, faute de quoi chacun finit par se protéger seul.
Il estime que l’assimilation doit redevenir une exigence claire et non un slogan abstrait, parce que la communauté nationale — qu’on la voie comme héritée ou choisie — suppose un cadre culturel, linguistique et civique.
L’ambition du livre n’est pas de théoriser un programme politique.
Elle est de rappeler ce qui a fait tenir la France : le travail, la responsabilité, la communauté, la culture, l’effort partagé, la continuité des familles et la foi de ceux pour qui la vie ne se résumait pas à l’individu.
Il parle d’espérance, non comme d’un optimisme naïf mais comme d’un choix volontaire, presque combatif.
Royer pense que le pays devra affronter encore des mois difficiles, mais que ce chaos peut être une occasion de reconstruction à condition que les élites cessent de se réfugier dans l’abstraction.
Fils de paysan n’est donc pas un livre nostalgique.
C’est un livre d’alerte — et de reprise d’appui.
Royer ne dit pas « c’était mieux avant ».
Il dit : « nous avons oublié ce qui nous permettait d’aller vers l’avenir ».
Il ne propose ni fuite, ni colère, mais un redressement exigeant, fondé sur des valeurs anciennes qui ont prouvé leur efficacité : le travail, la responsabilité, l’enracinement, la fidélité et l’espérance.
VIDÉO: https://www.youtube.com/watch?v=pDJIu-ni2tk&t=157s
Crédit photo : DR
[cc] Article relu et corrigé par ChatGPT.
Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire