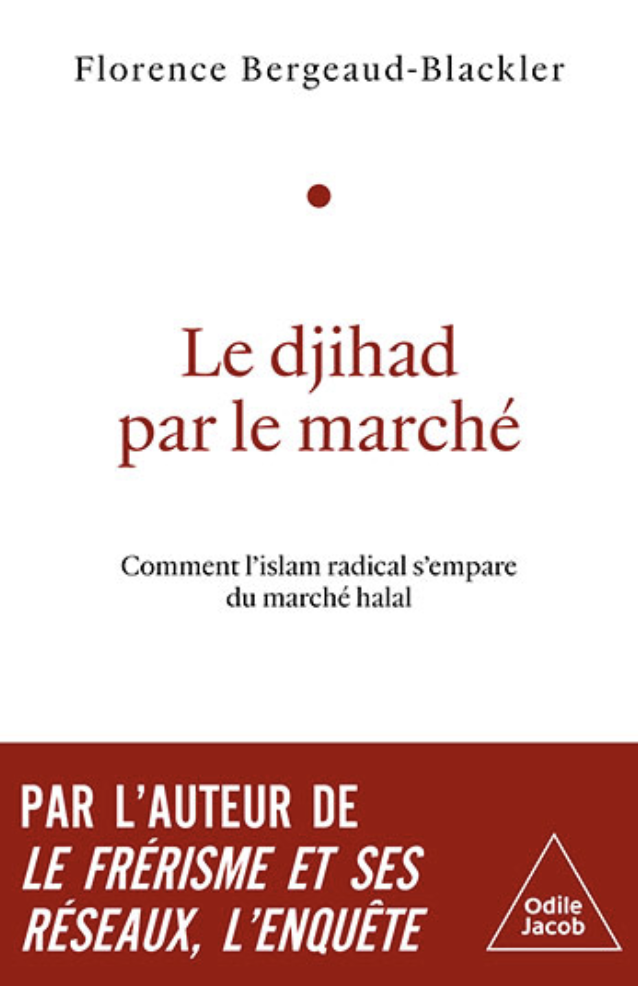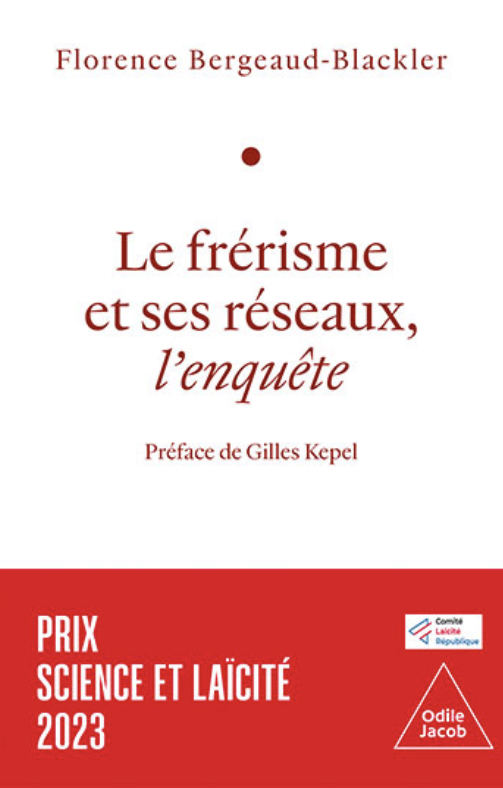Encore très récent, le marché du halal, désormais structuré, progresse rapidement, en France. Florence Bergeaud-Blackler, docteur en anthropologie (HDR), chercheur au CNRS et spécialiste reconnue du frérisme, vient de publier Le djihad par le marché (Éditions Odile Jacob), qui détaille les mécanismes du halal.
Elle répond aux questions de BV.
Étienne Lombard. Quelles sont les raisons qui expliquent la hausse de la demande de viande halal et, donc, la progression de ce marché ?
Florence Bergeaud-Blackler. Un marché, c’est une rencontre entre une offre et une demande. Quasi inexistante en France jusqu’à la fin des années 1970, l’offre de viande halal s’est véritablement structurée dans les années 1990.
On a alors vu la population musulmane se tourner massivement vers cette offre.
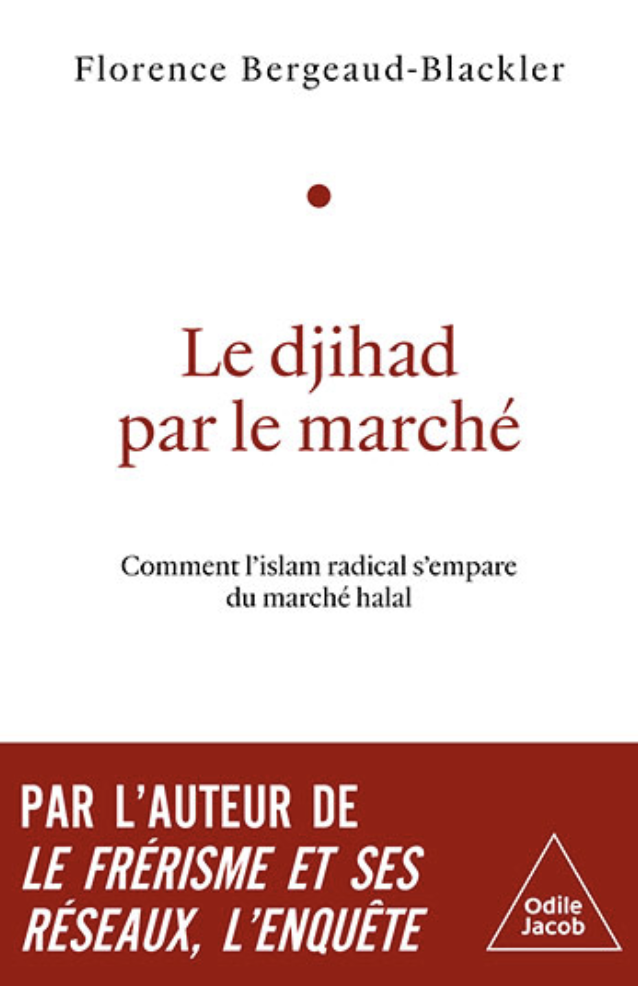
É. L. L’abattage étant aujourd’hui industrialisé, pouvez-vous nous expliquer comment s’est développé et organisé l’abattage halal industriel ?
F. B.-B. L’abattage conventionnel s’est industrialisé dès le XIXe.
L’abattage halal, lui, s’est formalisé dans les années 1980.
Ce n’est absolument pas un abattage traditionnel. Il s’agit plutôt de l’islamisation d’un abattage industriel selon un modèle tayloriste qui repose sur la division du travail, la standardisation des gestes et la recherche de rendement maximal.
Ce protocole d’abattage a été mis au point, notamment, par les mollahs iraniens envoyés dans les abattoirs occidentaux dans les années 1980, qui ont bénéficié des aménagements prévus pour les shokhatim juifs, lesquels fréquentent les abattoirs depuis bien plus longtemps.
La casherout existe en Europe depuis des siècles, le marché halal n’a même pas un demi-siècle.
É. L. Comment l’abattage halal, qui est une exigence rituelle religieuse, cohabite-t-il avec un État qui se veut laïc et des acteurs économiques dont la religion n’est pas la priorité ?
F. B.-B. L’abattage halal est le produit d’une convention industrielle entre trois acteurs : religieux, vétérinaires (l’État) et économiques.
Chacun y voit ses intérêts : les religieux évidemment, l’État qui réduit les abattages clandestins et les acteurs économiques qui peuvent faire des affaires.
Il n'y a pas de contrôle public de la filière halal
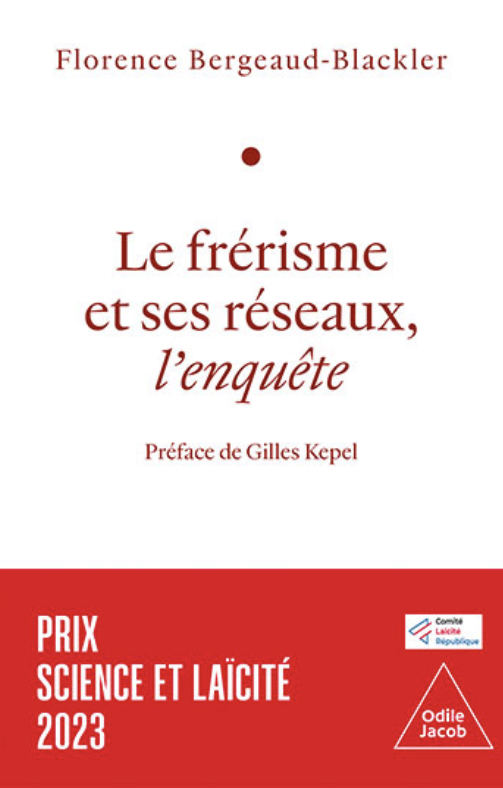
É. L. Comment le halal est-il contrôlé et quel est son périmètre ?
F. B.-B. Il n’existe pas de définition officielle de la norme halal.
En revanche, une convention informelle s’est imposée, autour de laquelle s’accordent les principaux acteurs de la production, de la réglementation et de la consommation.
Selon cette convention, l’animal doit être abattu dans un abattoir industriel, de préférence tourné en direction de La Mecque, par un musulman titulaire d’une carte de sacrificateur, délivrée par l’une des trois mosquées agréées en France, et sans étourdissement préalable. Il n’existe aucun contrôle public de cette filière.
Des organismes certificateurs privés proposent leurs services pour attester que la viande est conforme aux exigences halal.
Mais, là encore, aucune obligation légale ne s’impose. Le contrôle porte généralement sur l'acte d’abattage, l’environnement de production (absence de porc ou de contact avec des substances illicites) et la traçabilité afin d’éviter tout mélange avec des produits non halal.
É. L. Vous décrivez un monde du halal qui n’est pas monolithique et qui fonctionne avec des acteurs « hybrides ». Qu’entendez-vous par là ?
F. B.-B. J’appelle « hybrides » ces acteurs privés, contrôleurs, acteurs de la certification, influenceurs ou organisme de défense des consommateurs musulmans qui se présentent comme des experts religieux et qui s’enrichissent de la commercialisation des produits halal. Ils contribuent à édicter les règles et à contrôler leur application, et sont un peu juge et partie.
É. L. Comment le halal s’adapte-t-il aux outils modernes, médiatiques, numériques ?
F. B.-B. Le halal est désormais sorti des seules boucheries : il s’applique aujourd’hui à l’ensemble des produits de consommation.
Prenons l’exemple, parmi d’autres, de la grande mosquée de Paris.
Depuis juin 2023, l’Algérie exige que toutes les marchandises relevant du domaine du halal et en provenance de l’Union européenne portent le cachet de certification délivré par le recteur de la grande mosquée de Paris.
Sans ce visa, aucune de ces marchandises ne peut entrer sur le territoire algérien.
Selon le cahier des charges de janvier 2023, le domaine du halal inclut non seulement les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, mais aussi les produits pharmaceutiques, les produits cosmétiques et (je cite) « tout produit non consommable dont le processus de fabrication nécessite un contrôle strict en vue d’une certification halal ».
Autrement dit, tout peut potentiellement être halalisé.
É. L. En quoi le halal, qui prétend veiller à la qualité alimentaire et environnementale, peut-il constituer un danger ?
F. B.-B. Le danger ne réside pas dans le principe de tabou alimentaire mais dans l’extension du halal à des sphères toujours plus larges de la société, selon une logique de contamination, de séparation du pur et de l’impur.
Si des enfants apprennent dès leur plus jeune âge que le non-halal est « interdit », impur, contaminant, comment expliquer, ensuite, qu’ils doivent manger à la cantine avec les autres ou même respecter les mêmes règles que les autres qui sont, eux, impurs par contamination ?
L’introduction du principe de pureté, même si elle n’est pas formulée explicitement, est rigoureusement incompatible avec les sociétés de classes et non de « castes », démocratiques et égalitaires.

https://www.bvoltaire.fr/entretien-pour-lislam-radical-tout-peut-etre-halalise/?utm_source=Quotidienne_BV&utm_campaign=3f2541085c-MAILCHIMP_NL&utm_medium=



/image%2F0931529%2F20251231%2Fob_7037aa_tj-saint-sylvestre-2025.jpg)