REVUE DE PRESSE !
ET AUSSI
Un policier en prison, un squatteur sans papiers érigé en martyr : bienvenue en France
Il s’appelle Éric G., il a 26 ans, il est policier.
Un matin de juin 2024, il accourt chez sa grand-mère de 94 ans, réveillée par des bruits suspects.
Il découvre dans son garage un squatteur sans papiers, déjà connu des services de police.
Il se présente, appelle le 17, demande du renfort.
Et quand l’homme se jette sur lui, il tire.
Depuis quinze mois, c’est lui — le policier, le petit-fils, le Français ordinaire — qui croupit en prison.
La France des juges, celle qui protège le coupable et punit le défenseur
Dans un pays normal, on aurait salué le sang-froid d’un fonctionnaire qui a tenté d’arrêter seul un intrus.
Dans le nôtre, on le jette en détention provisoire comme un malfaiteur.
Les juges invoquent un « risque de renouvellement », comme s’il allait demain refaire le même geste — sur qui ? sur un autre squatteur, dans le même garage ?
On frôle l’absurde.
Mais la logique n’a plus sa place dans cette affaire.
Car il ne s’agit plus de justice, mais d’idéologie.
Le squatteur est étranger, sans papiers, et donc immédiatement sanctifié.
Le récit est déjà écrit, et les magistrats ne font qu’en tourner les pages.
La légitime défense criminalisée
Ce drame n’est pas une première : à Marseille, à Nîmes, à Lyon, combien de policiers, de boulangers, de retraités se sont retrouvés devant les tribunaux pour avoir simplement voulu protéger leur vie ou leur bien ?
Dans la France d’aujourd’hui, la légitime défense n’est plus un droit, c’est une suspicion.
On ne demande plus : « que s’est-il passé ? »
On demande : « qui êtes-vous, et à quelle case sociale ou ethnique appartenez-vous ? »
Le squatteur, lui, ne devait même pas être sur le territoire.
Mais dans ce pays fatigué, c’est désormais le citoyen honnête qui doit se justifier d’être encore debout.
Une justice de la peur et du symbole
Éric G. a appelé les secours, tenté de réanimer celui qu’il venait de neutraliser.
Il a fait ce que lui avaient appris ses instructeurs.
Mais dans le climat politique actuel, il paie pour tous les autres.
Pour Nahel, pour les polémiques, pour la peur des banlieues.
Les juges ne jugent plus un fait — ils administrent un message : « Ne touchez pas aux victimes officielles de la République. »
Et s’il faut briser un policier pour rassurer les agitateurs, qu’il en soit ainsi.
Deux familles détruites, une nation blessée
Le jeune homme, aujourd’hui, sombre dans sa cellule.
Sa mère raconte ses visites du mercredi, ses sanglots, ses pensées noires.
La grand-mère, celle qu’il voulait protéger, est morte sans avoir su qu’il était en prison.
C’est une tragédie française, au sens classique du terme : la vertu sacrifiée, la justice aveugle, le pays impuissant.
Cette République qui punit ses défenseurs
On parle beaucoup d’« ordre républicain ».
Mais quel ordre peut subsister quand celui qui défend la loi est traité pire qu’un criminel ?
Quand les magistrats se prennent pour des militants ?
Quand la peur de « choquer » remplace la notion de justice ?
Éric G. a tiré pour ne pas mourir.
Et depuis quinze mois, c’est lui qu’on laisse mourir à petit feu, derrière les murs d’une prison.
Dans cette inversion totale des valeurs, la France ne se reconnaît plus.
Et c’est peut-être cela, le véritable drame.
ET AUSSI
SNCF : la France sabotée par l’ultragauche dans l’indifférence générale
Encore un sabotage. Encore des milliers de voyageurs bloqués.
Et encore une fois, la même rengaine : « la piste de l’ultragauche est envisagée ».
Envisagée, oui.
Jamais assumée, jamais combattue frontalement.
Et pourtant, tout le monde le sait : il existe en France un terrorisme idéologique qui ne se cache plus.
Il brûle des câbles, détruit des infrastructures, s’attaque à la collectivité — au nom de la « lutte contre le capitalisme », de « l’écologie radicale » ou d’une haine maladive de l’ordre et de la France.
L’ennemi intérieur, mais sans nom
Un « incendie volontaire » sur les lignes du TGV Sud-Est, des retards en cascade, des trains déviés, des voyageurs pris au piège : voilà la France du quotidien.
Un pays où l’on peut paralyser le réseau ferroviaire le plus performant d’Europe sans que personne ne parle de terrorisme, sans que les ministres osent nommer les coupables, sans qu’aucune force politique ne demande de comptes à ceux qui couvrent, minimisent, ou excusent.
La vérité, c’est que la violence d’extrême gauche ne choque plus. Elle est devenue une sorte de bruit de fond.
On s’indigne poliment, on promet une enquête, on passe à autre chose.
Si c’était la droite, il y aurait des plateaux entiers, des éditoriaux, des commissions d’enquête.
Mais là ? Rien. Silence.
Pas un mot de la grande presse sur la radicalisation rouge qui sape nos infrastructures, bloque nos universités et incendie nos dépôts.
Le pays tenu en otage par les nouveaux vandales
Ce sabotage ferroviaire n’est pas un simple fait divers.
C’est un acte politique, au sens fort du terme : faire mal à la nation pour lui faire peur.
C’est une stratégie ancienne — celle de l’attaque du réseau, du sabotage économique, de la désorganisation du pays pour affaiblir l’État.
Et pendant ce temps, des milliers de Français sont cloués dans des gares, fatigués, exaspérés, payant le prix fort d’une guerre qu’ils n’ont pas déclarée.
L’État dépense des centaines de millions d’euros pour sécuriser les lignes, mais refuse d’affronter la racine du problème : une mouvance violente, structurée, protégée par une partie de la gauche culturelle et syndicale.
Ces gens ne se cachent même plus. Ils s’affichent, revendiquent, justifient. Et le pouvoir recule.
La gauche morale et le désordre réel
On nous répète que la menace viendrait toujours d’un autre bord.
Que la seule violence politique dangereuse serait celle du « populisme ».
Mais le réel, lui, ne ment pas : depuis des années, c’est bien l’ultragauche qui attaque.
Les ZAD, les black blocs, les groupuscules écologistes radicaux — tous œuvrent avec la même méthode : incendier, bloquer, paralyser, casser.
Et qu’obtiennent-ils ?
Des plateaux de télévision, des indulgences universitaires, et parfois même des subventions culturelles.
C’est la France à l’envers : celle où celui qui détruit le bien commun est excusé, pendant que celui qui travaille est suspect.
Reprendre le contrôle, ou s’habituer à la décadence
Le ministre des Transports l’a dit : « Le réseau ferroviaire, c’est le patrimoine des Français. »
C’est vrai.
Mais alors, pourquoi ce patrimoine est-il laissé à la merci des incendiaires ?
Pourquoi notre pays semble-t-il accepter l’idée que l’on puisse brûler ses lignes, casser ses trains, ruiner ses ponts — sans que rien ne change ?
Ce n’est plus seulement un problème de sécurité : c’est un problème de civilisation.
La France a le choix : reprendre le contrôle de son territoire et de ses infrastructures, ou s’habituer à vivre sous la menace permanente des casseurs politiques.
Et pour cela, il faudra un jour appeler les choses par leur nom : oui, l’ultragauche est devenue un danger national.
Source : https://lalettrepatriote.com/
jmlb
Le syndicalisme àla SNCF ...;;


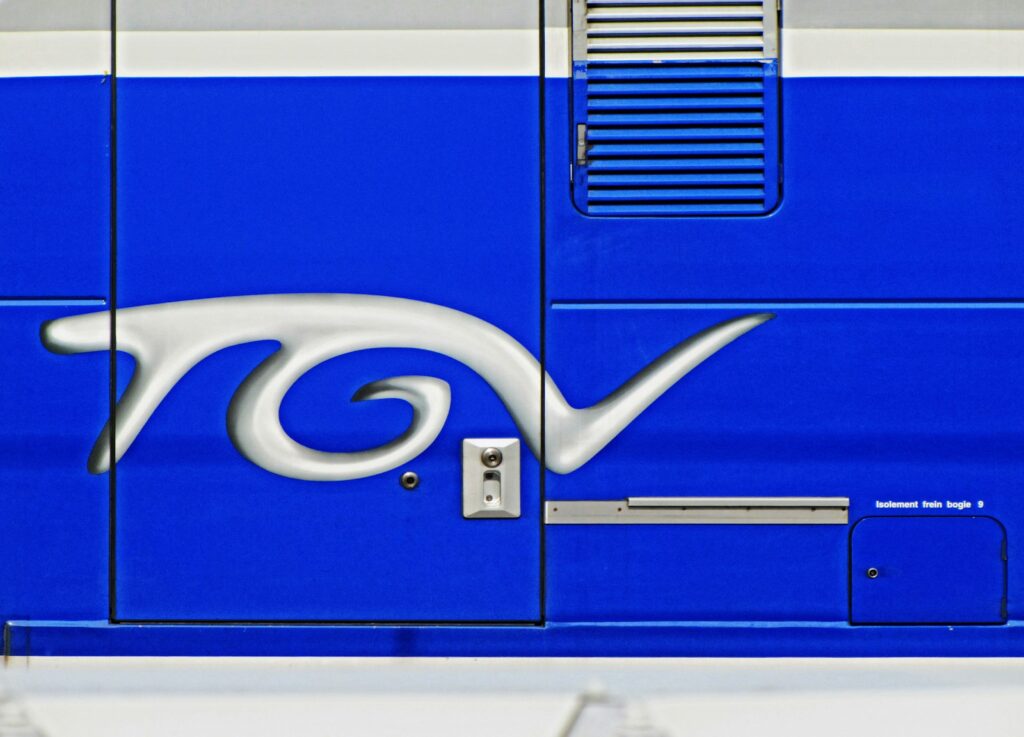

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire